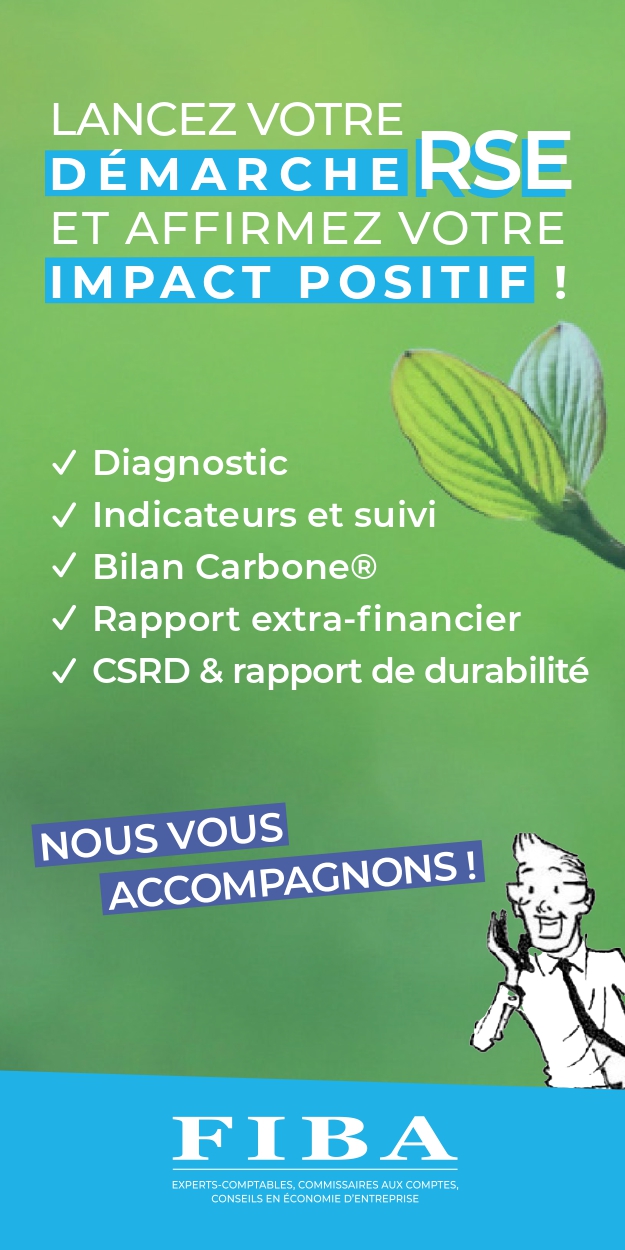Du sacré ?|Le parti pris de Thierry Jobard
Article publié dans Or Norme N°57 (juin)
Lequel d’entre nous n’a pas son ou ses livres, films, séries cultes ? Qui n’a pas d’objet fétiche ou bien ne considère pas tel ou tel accessoire comme mythique ? Mais n’est-il pas étrange que ce vocabulaire bien laudateur et bien connoté soit employé pour désigner ce qui relève de la production de masse ?
Étrange, il faut bien que cela le soit un tantinet sans quoi cet article n’aurait pas de raison d’être. Tentons donc de nous en persuader.
Faisons d’abord la part de la démonétisation du langage qui tend à nous faire accroire qu’un nouveau parfum de glace peut être génial et qu’il faut s’ébaudir devant chaque manifestation de l’une des plus hautes valeurs de notre société : la nouveauté. Il faut bien se constituer son petit Panthéon de goûts et de couleurs dont on sait qu’ils en disent trop sur nous pour qu’on en veuille discuter (à savoir que nos goûts ne sont pas de vrais choix mais le reflet de déterminations sociales).
Mesurons la part du marketing et de la publicité qui imbibent nos existences au point qu’on finit par croire que les qualités des produits vantés sont réelles ou qu’elles nous apporteront un supplément d’être. Il faut acheter parce qu’il faut vendre et tout se vend et tout s’achète. Et si on ne peut pas acheter ? On s’endette.
Ceci hâtivement ôté, que nous reste-t-il. Officiellement une République laïque et démocratique (et sociale, mais ça c’était avant ; et démocratique mais sans excès). Après des siècles à bigorner avec les bigots, le roi de France contre le Pape, la République contre l’Église, la laïcité s’est imposée. Laïcité qui, je le rappelle du fait des détournements dont elle fait actuellement l’objet, permet la liberté de conscience de chacun sans emmerder ses voisins. Depuis le XXVIIIe siècle pour le bassin parisien, plus tardivement pour d’autres régions, le christianisme s’est peu à peu effondré, avec une accélération dans les années soixante. Déchristianisation et sécularisation sont des phénomènes de longue durée et tout pourrait sembler aller pour le mieux dans une société laissant chacun libre de croire ou de ne pas croire et de croire ce qu’il veut ou peut.
« Il y a les principes et il y a les rapports de force, il ne faut pas confondre. »
Or, les anthropologues l’ont établi, il n’existe pas de société qui ne produise du sacré. Si on ne peut sérieusement envisager qu’il se niche dans une pile de jeans ou une nouvelle production (le terme est à prendre au sens premier d’artefact mis sur le marché de l’attention) de l’industrie cinématographique, alors se pose la question : où c’est qu’il est donc le sacré aujourd’hui ? On pourrait avancer, la main sur le cœur et les yeux embués, que la vie est sacrée. Oui mais ça dépend, comme disent les élèves de terminale en cours de philosophie. Quand la vie commence-t-elle ? À combien de mois de gestation ? Et quand finit-elle ? Peut-on en décider ? En ce cas elle n’est pas sacrée. Ça frictionne déjà. Et l’on sait pertinemment que toutes les vies ne se valent pas, in concreto. Il y a les principes et il y a les rapports de force, il ne faut pas confondre. Non pas qu’il ne faille pas avoir de principes. Mais si on ne se donne pas les moyens de les appliquer, on finit toujours par avoir mal aux fesses. Et bien que ça nous paraisse aujourd’hui remonter au Déluge, durant la Première Guerre mondiale mourraient en moyenne presque 1000 Français chaque jour. Le record : 27 000 le 22 août 1914. (Je vous prie respectueusement de bien vouloir faire une pause dans votre passionnante lecture le temps d’y penser.)
Le sacré c’est le « tout-autre ». La vie valait-elle moins il y a 110 ans ? Le deuil était-il plus doux et la peine moins profonde ? Assurément non. Mais la défense du territoire le justifiait, ainsi que l’Amour sacré de la Patrie1. Ne surestimons pas non plus le patriotisme des Poilus (nonobstant bien réel). Défendre sa patrie c’est aussi défendre son village, sa maison, sa famille. À ce titre, une autre guerre mondiale plus tard, ce n’est pas aux cris de Vive Staline ! ou Vive l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (c’est trop long d’ailleurs) que les vagues de fantassins contre-attaquaient mais plutôt, selon leurs propres dires, à ceux de Ta mère la pute !, voire Enculés de fascistes ! ou quelque chose d’équivalent2. La guerre est une terrible chose. Du moins se référait-on à quelque chose qui dépassait chacun et unissait tout le monde, soit une transcendance.
Commençons enfin par définir simplement ce dont il est question : le sacré est ce « qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable »3. Il fait l’objet d’une « référence religieuse » et s’oppose au profane, ce qui se tient devant et hors du temple selon l’étymologie (pro-fanum). Religieux, religion, le mot est lâché et les poils se hérissent ? Car l’on sait qu’aujourd’hui on lui préfère celui de « spiritualité », moins contraignant et qui permet toutes les interprétations, surtout les plus tartes. De plus, notre conception du religieux est surdéterminée par le monothéisme d’une part et il y a fort à parier, d’autre part, que notre vision de la Foi n’est pas celle qu’en avaient les hommes et femmes du XVIIe siècle ni cette dernière celle de ceux du XVe siècle. À supposer que toutes et tous avaient la même au surplus.
« Vivre c’est ici et maintenant puisque, comme le disent tous les jouisseurs, on n’a qu’une vie. »
Le monde moderne est une démagification. Sacré d’un côté, profane de l’autre, à la fois d’un point de vue spatial (le Saint des saints est réservé aux personnes consacrées) et temporel (on ne travaille pas le dimanche, en général). Mais encore d’un point de vue symboliquement spatial si l’on peut dire. Le sacré est un autre lieu, une autre réalité, un autre monde, paré de toutes les excellences : le « tout autre ». Mais aujourd’hui nous n’avons plus qu’un monde, d’ailleurs nommé la mondialisation, et le Paradis est un conte pour enfants. Vivre, c’est ici et maintenant puisque, comme le disent tous les jouisseurs, on n’a qu’une vie. Nous pataugeons dans l’immanence.
Le monde moderne est celui d’une démagification et d’une rationalisation croissante qui induit un contrôle de la nature, en vue de son exploitation. Les forces naturelles ne sont plus l’expression d’un pouvoir surnaturel mais de simples phénomènes physiques. L’économique a acquis une existence propre, celle de l’échange abstrait en fonction du prix, au contraire des sociétés traditionnelles qui pratiquaient le don et le contre-don4.
Mais peut-on se satisfaire de ce désenchantement du monde, selon l’expression de Max Weber (1864-1920) ? Ce qui nous ramène à la question : quel sacré émane-t-il de nous ? Entendu que le sacré revêt une double dimension : à la fois ce qui est séparé, préservé, sublime, et ce qui est effrayant, dangereux, horrible et dont il faut se ménager les bonnes grâces. Le sacré est vénéré parce que craint également. C’est ce qu’établit Rudolf Otto dans un texte essentiel sur la question5 en avançant la notion de numineux pour qualifier le sentiment mêlant attirance et répulsion vis-à-vis d’une puissance surnaturelle. En ce sens, le sacré précèderait l’instauration de toute religion, comme un fond archaïque toujours prêt à s’investir dans telle ou telle forme ritualisée. Et celle-ci est collective, partagée, commune. Or le surnaturel n’existe plus pour nous, à part dans les risibles délires ésotériques et New Age contemporains, et, là encore, aucune crainte puisque l’univers est un ami généreux et bienveillant. Peut-être l’émergence d’une conception, contestée, de la nature comme être vivant s’auto-régulant, voire capable de se venger6 remplira-t-elle cet espace du sacré, après avoir vaincu bien des réticences. Icelles étant souvent le reflet d’intérêts bien compris (il vaut mieux faire du pognon et ne rien céder sur son confort plutôt que de préserver notre environnement, c’est évident). Le sacré c’est aussi ce qui nous limite et aux limites nous y sommes. Comme vous l’aurez remarqué, on tourne en rond. ←
1. Sixième couplet de la Marseillaise, mais on ne le connaît pas.
2. Nikolaï Nikouline, Carnets de guerre 1941-1945, Les Arènes, 2019
3. D’après M. Robert.
4. Voir, entre autres, Marcel Mauss, Essai sur le don, PUF, 2012
5. Rudolf Otto, Le sacré, Payot, 2015
6. James Lovelock, La Terre est un être vivant, L’hypothèse Gaïa, Flammarion, 2010