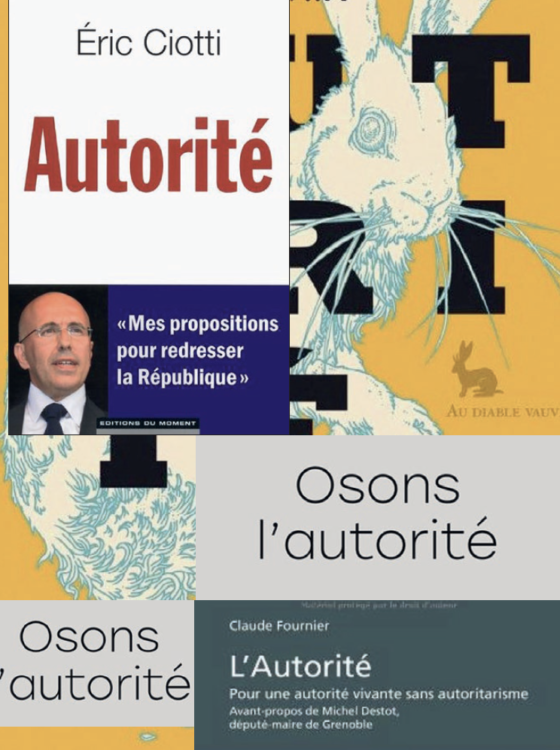Otorhité ? I Le parti-pris de Thierry Jobard
C’est la rentrée. Ça sent l’automne, le monoxyde de carbone et les crayons tout neufs. Chacun va s’affairer de nouveau dans sa petite routine, les uns trottinant pour s’agglutiner avec leurs camarades, les autres clopinant pour retrouver leurs collègues infects. Et tous vont demander, réclamer, espérer une chose qu’en même temps ils vont dénoncer, rejeter, vilipender. C’est amusant l’être humain, ça veut une chose et son contraire.
Je n’ai aucune imagination et le temps pressait pour trouver un sujet. Militer pour une journée naturiste dans les piscines publiques ou bien la création d’un permis de chasse aux utilisateurs de trottinettes (trottinétistes ? trottinettos ? trotteballes ?) n’est semble-t-il pas de saison. Fort heureusement, entre un cahier de coloriages pour adultes (c’est bon contre le stress), un recueil de blagues de Bigard et le dernier titre de Natacha Calestrémé, se trouvait sur ma table de chevet le livre d’un de nos grands hommes politiques, Éric Ciotti. Il s’agit d’Autorité. (1) Titre sobre et imposant en même temps, plein d’une forte résolution et d’une mâle vigueur (avec le petit assent du sud en prime). Il est bon de voir réaffirmer haut et fort certaines vérités premières : « La France s’en sortira quand le politiquement correct qui a annihilé autorité, mérite et responsabilité aura cédé sous la volonté de tout un peuple de retrouver ses vraies valeurs ». Youpi ! « J’entends démontrer dans ce livre qu’il est possible d’en finir avec cette démission généralisée ». Chauffe Marcel, chauffe ! Tout cela énoncé par un « Élu de terrain déterminé qui assume ses convictions » et qui veut « dire avec force que seul le manque de volonté politique est responsable du déclin français ». Et autres coquecigrues du même tonneau.
L’autorité ça s’autorise
Nonobstant, il s’agit tout de même de « restaurer l’autorité comme valeur première ». La liberté, l’égalité ou la fraternité, moi je veux bien, mais l’autorité ? Je vois d’ici poindre l’argument : sans autorité pas de liberté ni d’égalité, ni quoi que ce soit d’autre. Sans autorité tout fout le camp ma bonne dame. L’autorité des parents sur les enfants, l’autorité des enseignants sur les élèves, l’autorité des chefs d’établissement sur les enseignants, l’autorité de la loi… il est vrai, tout n’est qu’autorité. Un esprit mesquin aura tôt fait de brandir le taux de suroccupation des prisons de France pour arguer d’une autorité battue en brèche. Sans parler du petit Brandon qui doit copier cent fois « Je ne dois pas traiter de pute la mère à Jessyfer ». Voilà de l’eau pour le petit moulin d’Éric Ciotti. En attendant, Brandon copie ses lignes. D’où l’intérêt de bien définir ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Les termes du débat sont en effet à ce point faussés que qui n’est pas tenant de l’autorité est partisan du laxisme. Ce qui réduit beaucoup la marge de manoeuvre et de réflexion. Pour commencer, l’autorité ce n’est pas la répression. Ce n’est pas non plus parce qu’elle est toujours suspectée d’abus (qui n’arrivent que trop fréquemment) l’autoritarisme, ni la coercition. En un mot comme en cent, l’autorité ça s’autorise. On retiendra donc cette définition toute simple, celle du Larousse : « Pouvoir de décider ou de commander, d’imposer ses volontés à autrui ». L’autorité ne se démontre donc pas, elle s’exerce. Ce n’est ni la force (même si elle peut y recourir), ni la persuasion. Et toute autorité n’est pas un autoritarisme ; il existe des autorités douces. Quoi qu’il en soit, l’autorité n’existe que tant qu’elle est légitimée. Légitimée par quoi ? C’est toute la question.
Ce discours sur la crise de l’autorité n’est pas une nouveauté. Il y a soixante ans déjà, Hannah Arendt en parlait.(2) Selon elle, si crise de l’autorité il y a, au point de parler d’« un effondrement plus ou moins général, plus ou moins dramatique, de toutes les autorités traditionnelles », la volonté de les restaurer est illusoire. En effet, l’entrée dans des sociétés de masse rend caduc le recours à la transcendance qui légitimait cette autorité. Celle-ci a une origine romaine, l’auctoritas. Et elle était clairement distinguée de la potestas, le pouvoir lui-même. L’auctoritas relevait du Sénat, qui émettait des conseils qu’il eût été mal avisé de ne pas suivre. Pas des ordres, ni des lois, des conseils… Ainsi que le résume plaisamment Cicéron : Cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit. (3) La légitimité implique donc la reconnaissance et l’implication de ceux sur lesquels elle s’exerce. Cette distinction entre auctoritas et potestas sera réactivée à la fin de l’Empire afin de dissocier le magistère moral de l’Église du pouvoir royal. Cette sorte de dyarchie tiendra plus de mille ans.
Notre avenir tient dans un agenda
Arendt va plus loin cependant en écrivant : « En pratique aussi bien qu’en théorie, nous ne sommes plus en mesure de savoir ce que l’autorité est réellement ». Ce qui ne ravira pas Éric Ciotti. Pourquoi cela ? D’une part parce que ce qui légitimait l’auctoritas, c’était la transcendance que représentaient les valeurs morales fondatrices de la République romaine. Et donc une conception du temps selon laquelle plus on s’éloignait de cette origine, plus on déclinait. De là la nécessité du travail permanent de perpétuation de la vertu. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, notre paradigme était tout autre puisqu’orienté, lui, vers l’avenir. On appelait ça le progrès. Aujourd’hui notre avenir tient dans notre agenda. Pour résumer, le passé pour nous, c’est tout nul, et le futur, c’est tout moche. Nous sommes donc en panne de transcendance.
Histoire de corser encore un peu les choses, Arendt précisait : « La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu’ils ont en commun c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée ». Hiérarchie, voilà un mot dissonant pour nos oreilles postmodernes. Dans une version actualisée de son Dictionnaire des idées reçues(4), Flaubert écrirait sûrement : « Hiérarchie : tonner contre ». Car une société démocratique, Tocqueville l’avait déjà vue, c’est une société des égaux. Et l’esprit français est ainsi fait que l’on préférerait être tous également pauvres plutôt que tolérer trop d’inégalités. C’est dire à quel point elle dure la longue patience du peuple. Dans l’entreprise par exemple, on ne parle plus de hiérarchie, ni de subordonnés, on parle de collaborateurs. Que personne ne s’affole, ce n’est que de la graine vide pour appâter les niais. Le pouvoir est toujours là, seulement il n’est plus contrainte mais persuasion. En somme on lubrifie.
C’est la reconnaissance collective qui assure la pérennité de l’autorité
Mais dans une société du changement perpétuel, de l’adaptation permanente, dans laquelle les crises deviennent des états habituels et la résilience une vertu cardinale, toute hiérarchie semble friable.
Il y a des explications à cela. Déjà la recomposition permanente des identités. Auparavant elles étaient définies au préalable et une fois pour toutes. Le sentiment d’appartenance (à une famille, à un groupe, à une église ou à une entreprise) allait de soi. Tel n’est plus le cas. Se rattache à cela une forme d’individualisme autoréférentiel promouvant une autonomie totale. Tout ce qui est dit ou pensé doit être respecté de la même façon, et remettre en cause une opinion, une orientation, une représentation revient à porter atteinte à la substance ontologique de l’individu. Ce qui ne favorise guère le débat d’idées. Et de surcroît, induit une remise en cause de l’autorité épistémique, de l’autorité intellectuelle. Que tu n’entraves que couic à ton texte du bac de français après quatorze ans passés à l’école ne signifie pas que ledit texte soit naze, petit babouin, mais bien que tes capacités de compréhension de ta propre langue sont une honte pour la Création toute entière. Pour prendre un exemple récent et désormais récurrent.(5) Bref, tout devient discutable.
Comme nous l’avons vu, c’est la reconnaissance collective qui assure la pérennité de l’autorité. Mais si la société devient un agrégat d’individus vibrionnants, quid du fameux vivre ensemble ? On se crée des petits cercles, des petits groupes homogènes, on pratique l’interrelationnel, pas le collectif. L’allergie à l’autorité n’est telle que parce qu’elle est sans cesse rabattue sur l’autoritaire, héritage du vingtième siècle totalitaire. Or pour assumer une réelle autorité, c’est-à-dire une forme de pouvoir à la fois juste et mesuré, dans ce contexte déjà évoqué d’hypersensibilité, il faut un courage et une endurance que peu possèdent. Il n’est qu’à voir le nombre de bouquins de management qui paraissent chaque année pour comprendre que cela ne s’apprend ni ne se décrète. Ou bien on se réfugie derrière des normes, des procédures et des règles naturalisées. C’est la grosse tendance du moment ; tendance lâcheté.
Alors, morte l’autorité ? Ça se peut bien. Mais que reste-t-il alors ? Tout ce qu’elle n’est pas : violence, coercition, manipulation, abus de pouvoir. C’est pas cool la vie.
(1) Autorité, Éric Ciotti, éditions du Moment. Hélas le livre est épuisé.
(2) Hannah Arendt, Qu’est-ce que l’autorité, in La crise de la culture
(3) « Le pouvoir réside dans le peuple, l’autorité appartient au Sénat », dans Contre Pison, IV
(4) A lire et relire, ça stimule le sang. (5) #soutienauxprofs