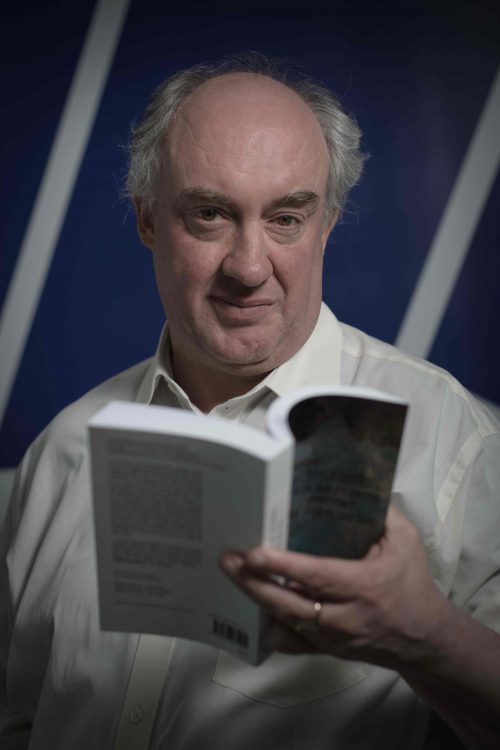Le Livre de Ma Vie #6
Barbara Roméro
L’insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera
La légèreté ou la pesanteur ? Plus que jamais lorsque j’étais étudiante en deuxième année de Lettres modernes, ces mots résonnaient dans mon esprit. Si je rêvais de devenir journaliste depuis l’âge de 17 ans, Kundera m’en a convaincue. Anecdotique sans doute pour beaucoup, le passage où le fils de Tomas « utilise » un journaliste pour pouvoir approcher ce père qui l’a abandonné tout petit m’a profondément touchée. On est à Prague dans les années 1970, les intellectuels ont dû fuir le pays, les journaux sont muselés par les autorités russes. Tomas, pour avoir osé s’exprimer, a dû renoncer à sa carrière de chirurgien pour devenir laveur de vitres. Si je vivais dans un pays démocratique, je me suis souvenue de la manifestation en marge du congrès du FN qui avait rassemblé 50 000 personnes dans les rues de Strasbourg en 1997, et où j’avais défilé avec mon père. Jeune étudiante, pourtant pas mili- tante pour un sou, je me suis alors dit que je voulais vraiment exercer ce métier, écrire, faire parler les gens.
Celui qui, au nom des principes, renonce à la légèreté que procure l’amour pour finalement s’y laisser aller.
Je voulais que la parole reste libre et que la presse reste libre. Mais au-delà de ce sentiment de conviction né à travers les lignes de Kundera, j’ai bien sûr été imprégnée de ses personnages tragiques, Tomas, Tereza, Sabina, Franz. Entre le compagnon éperdument amoureux mais éperdument adultère. La compagne meurtrie par l’amour. Celle qui se perd dans la vacuité. Celui qui, au nom des principes, renonce à la légèreté que procure l’amour pour finalement s’y laisser aller. Ces personnages en quête d’un sens. Du haut de mes 20 ans, Kundera m’a portée dans toutes les facettes que pouvaient prendre les relations, et m’a amené à m’interroger sur celle que je voulais devenir.
Légère ou profonde ? Je crois que je l’ignore toujours !
Sandrine & Bernard Alexandre
C’est une chose étrange à la fin que le monde, Jean D’Ormesson
Nous aimons, comme Jean d’Ormesson, nous baigner dans la Méditerranée sous la chaleur de juillet. C’est le point de départ du livre. Les points communs font cependant aussi les différences car nos cartes postales estivales n’ont pas, de près ou de loin, l’ampleur de celles du grand écrivain. Il est vrai que ne se met pas qui veut alternativement dans la peau de Dieu, du scientifique ou du philosophe pour s’interroger aussi puissamment sur le monde, en sortant d’une baignade. Avec cette question si essentielle qu’on s’étonne qu’elle nous ait échappé avant la lecture de l’ouvrage : pourquoi et comment y a-t-il quelque chose au lieu de rien ?
Le livre a été publié alors que nous passions précisément le cap de nos 20 ans de mariage. Le type d’anniversaire qui donne envie de s’arrêter pour regarder derrière et devant soi. Un moment propice pour s’interroger comme le fait Jean d’Ormesson : « Et nous qui avons la chance d’être nés et de ne pas être déjà morts : que faisons-nous sur cette terre ? ».
C’est certainement pour cette raison que nous avons tous les deux, chose rare, été tant touchés par le même livre. Jean d’Ormesson possède cette érudition à la fois immense et accessible, humble et souriante, qui nous happe, pour nous éclairer. Chacun trouve à la lecture de ces pages sa vérité car la leçon est qu’il n’existe pas qu’une vérité et que paradoxalement le meilleur moyen d’avancer est certainement de douter. « Je doute de Dieu parce que j’y crois. Je crois à Dieu parce que j’en doute », écrit avec virtuosité l’auteur. Jean d’Ormesson confesse avoir été changé par l’écriture de son livre. Il nous a aussi changés conjointe- ment en nous aidant, comme il le propose, à trouver le monde moins absurde même s’il reste une énigme. Comme l’amour.

Christian Lutz-Sorg
Poèmes, 1949-1995, Heiner Müller
Il y eut d’abord cette carte postale maladroitement envoyée à une ancienne adresse. Puis un rendez- vous d’après spectacle, où il avait donné Der Mann im Fahrstuhl au rythme de la musique d’Heiner Goebbels. Dans la loge du TNS respectant la liturgie du whisky et du havane, tout de noir vêtu, Müller apparaissait en homme premier, comme on le dirait d’un nombre.Du coup, les divisions le concernait peu, voire pas du tout. Sa voix grave flottait, enrobée par les volutes du double Corona. Les mots évoquaient d’anciens haïkus, faisant s’entrechoquer vers et verres en une élégante mélopée.
Ces rimes brutales subtilement provocatrices et l’ouvrage qui les recueillait n’ont jamais plus quitté le bagage léger d’un jeune homme tout juste entrain d’écrire le brouillon de sa vie professionnelle. Le petit volume a roulé, au fond d’un sac de voyage le long des routes, s’est abîmé dans des soutes dépressurisées, a ressuscité sous les soleils les plus aléatoires.
Comme il se doit, l’ouvrage frappé à l’effigie de son auteur fut lu en géographies imposées. Contrées brutales pour célébrer Maïakovski et son plomb pour point final ou devant ces étranges portes de Go qui se refermeront, refusant du vin au Genosse Honneker. Cinq vers pour Brecht devant le Berliner Ensemble, quelques un de plus établissant pour toujours l’im- mensité d’Anna Seghers alors qu’on cherchait un Ith1aq3ue, et forcément trois lignes sur la fidélité des communistes au Karaganda. Et puis, la nuit si délicate à déchiffrer, imposera pour toujours une haine des lumières de la station Berlin Friedrichstrasse.
Devenu indispensable, le recueil fut aussi sujet d’angoisses quand, oublié par mégarde dans un bouge croate, ou enfoui dans le désordre d’un bureau, il disparaissait momentanément. La cérémonie des retrouvailles, un peu ridicule, convenons-en, célébrait un soulagement. De cette rencontre littéraire aussi fortuite qu’ardemment désirée, reste ce privilège prélevé aux pages d’un livre, fait de déchirures entre le temps et l’histoire, qui inscrit poésie et théâtre résolument dans le besoin d’utopie.
Un Lehrstück voulu par Heiner Müller comme inséparable d’une œuvre comme d’un pays et qui reste en osmose avec Joseph Conrad, fidèle aux cauchemars de son choix.

Gabrielle et Aliza Rosner
La vie devant soi, Romain Gary (Emile Ajar)
Aliza
La couverture folio de La vie devant soi de Romain Gary (Emile Ajar), photo jaunie et plongeante d’une cage d’escalier sur plusieurs étages avec ces enfants penchés par dessus la rampe, traine un peu partout dans l’appartement. C’est l’été et moi, Aliza, je relis pour la deuxième fois en 12 ans le Prix Goncourt 1975. Dans ce livre, écrit par un adulte qui raconte comme un enfant, on se perd dans l’ordre des générations. Qui de Momo ou de Madame Rosa protège vraiment l’autre ? il n’y a pas d’âge pour être touché par ce tandem loufoque qui s’aime, et c’est sûrement pour cela qu’on n’a de certitude sur aucun des âges des deux héros.
Ma mère veux me le piquer, elle dit qu’elle ne l’a pas lu. Quelque chose m’échappe car quand j’étais petite, j’avais 10 ou 11 ans, c’est elle qui me l’avait conseillé. Même que j’avais pas compris pourquoi elle me faisait lire l’histoire « d’une vieille pute juive, qui se défendait avec son cul ». Mais j’avais fini le livre, sans être sure d’avoir tout bien saisi.
Gabrielle
Aliza vient de finir La vie devant soi, et je me plonge enfin dans ce récit qui lui a tellement plu. C’est un tsunami, un livre jubilatoire, pleins d’incongruités et de contresens assumés. C’est un livre libre, écrit par un homme libre. Toutes les pages me semblent contenir des répliques cultes. « C’est pas nécessaire d’avoir des raisons pour avoir peur Momo » ; « Moi je crois que les Juifs sont des gens comme les autres mais il ne faut pas leur en vouloir » Nous sommes dans le quartier de Belleville au début des années 70, il y a des Noirs, des Arabes et des Juifs, et parfois aussi des français. Plus de 20 ans que la guerre est finie, mais Madame Rosa « se protégeait de tous les cotés depuis qu’elle avait été saisie par la police française qui fournissait les Allemands et les plaçait dans un vélodrome pour Juifs. (…) Elle avait tout le temps peur, mais pas comme tout le monde, elle avait encore plus peur que ça ». L’étrangeté du récit, l’ironie grandiloquente, font jaillir la vérité à chaque page. Je me régale. C’est bien la première fois que je lis ce chef-d’œuvre. Alors comment ai-je pu le conseiller à ma fille lorsque celle-ci avait onze ans ? Seule explication possible, une confusion de ma part avec un autre titre de Romain Gary, La promesse de l’aube, livre lu plusieurs fois avec le même enthousiasme.
Je ne me l’explique pas. Mais une chose est sûre, on a la vie devant soi lorsqu’on a onze ans.
Emmanuel Abela
jusqu’à ce que les pierres deviennent plus douces que l’eau , Antonio Lobo Antunes
La relation qui me lie au livre est charnelle. Pour moi, elle débute par un véritable coup de foudre : parfois un mot, rien de plus, et cela suffit pour m’ouvrir à la sensation. En ce qui concerne le dernier António Lobo Antunes paru au tout début de l’année, nul temps d’appropriation. Dès la couverture j’ai rendu les armes : le choix d’un détail d’une œuvre du peintre symboliste Odilon Redon, tout comme le titre jusqu’à ce que les pierres deviennent plus douces que l’eau, écrit en minuscules, m’ont suggéré une suite d’éternités. Ce titre poétique, mais trompeur, ne dit pas la violence du contenu. Il ne dit rien non plus de la terreur qu’il installe au fil des pages ; or c’est le chaos ultime qui nous guette.
Avec cette histoire dramatique d’un sous-lieutenant et de son fils adoptif, kidnappé après le massacre de sa famille, l’écrivain portugais nous fait vivre sa guerre coloniale en Angola. Lui qui s’y refusait jusqu’à présent, donne voix à toutes ces bouches qui livrent de manière déchirante un constat, une pensée, une rêverie ou simplement la réalité d’un cauchemar éveillé.
Ce qui me plaît tant dans cette écriture extrêmement physique, proche de la dislocation, c’est qu’elle nous entraine non pas dans l’espace narratif des situations qu’elle relate, mais au cœur même des mots, sans distanciation, comme si nous nous fondions en eux et les vivions de l’intérieur. Ce merveilleux auteur nous le répète à l’envi : l’histoire, c’est le lecteur qui l’écrit. Lui, il nous fait croire qu’il se contente de nous indiquer une voie. Non sans malice, quitte à nous perdre souvent. Dans un premier temps, j’avais choisi Cap au pire de Samuel Beckett qui m’avait marqué en son temps, mais au tout dernier moment j’ai opté pour celui-ci : plus que tout autre, il constitue le livre d’une nouvelle vie à construire sur les décombres du passé.
La relation qui me lie au livre est charnelle. Pour moi, elle débute par un véritable coup de foudre : parfois un mot, rien de plus, et cela suffit pour m’ouvrir à la sensation.
Jean Rottner
Le Rouge et le Noir, Stendhal
Lorsqu’en 1830 Stendhal écrit Le Rouge et le Noir il fait souffler sur la littérature française un vent de liberté comme jamais.
Lorsque François Wolfermann m’a demandé de lui révéler quel était le « livre de ma vie », j’ai failli céder à la facilité et répondre à sa question par la célèbre phrase de Thomas d’Aquin : « Hominem unius libri timeo » ( je crains l’homme d’un seul livre).
Sauf qu’avec la littérature, nul ne peut jamais fuir ni se dérober. Elle nous convoque toujours entier et nous assigne à établir, pour nous-même, la vérité sur ce que nous sommes. Elle appelle à un dévoilement radical du monde, de la société, des tréfonds de l’âme humaine et des significations ultimes que nous prêtons, dans notre for intérieur, à notre propre vie. Elle opère comme un miroir inversé, où éclate au grand jour la profonde dichotomie entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être.
Dire que j’ai aimé Le Rouge et le Noir de Stendhal serait peu de chose. Je l’ai relu à quatre reprises et je ne suis pas sûr de m’arrêter en si bon chemin. Je suis sûr que les suivantes ne suffiront pas pour épuiser ce que Nietzsche lui-même admirait en Stendhal : sa « double vue psychologique ».
Certes, Stendhal est sec. Chez lui, jamais aucune manière ni aucunes fioritures. L’inverse de Balzac et de Flaubert. Mais lorsqu’en 1830 il écrit Le Rouge et le Noir il fait souffler sur la littérature française un vent de liberté comme jamais. Dans son Dictionnaire amoureux de Stendhal, Dominique Fernandez nous rappelle qu’Henry Beyle a créé le premier homme foncièrement libre de toute la littérature française. Mais le génie de Stendhal ne se limite pas à cela. Il ne se contente pas d’être le peintre des passions et des contradictions de l’âme humaine : il parvient à transcrire dans un destin humain toutes les passions et toutes les contradictions d’une époque donnée. Là se situe le génie de la littérature, quand elle nous offre de comprendre tout à la fois l’histoire des hommes et le récit de leurs passions.
Lisez Stendhal. Lisez Le Rouge et le Noir, pour comprendre ce qu’écrivait Rousseau : « Il vaut mieux être un homme à paradoxe qu’à préjugé. »